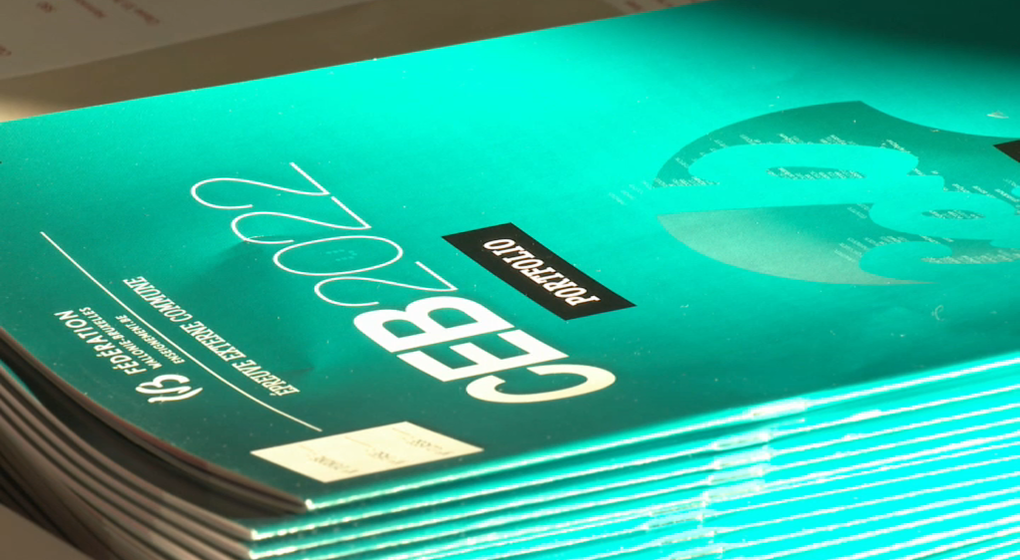[av_one_full first min_height= » vertical_alignment=’av-align-top’ space= » row_boxshadow= » row_boxshadow_width=’10’ row_boxshadow_color= » custom_margin= » margin=’0px’ av-desktop-margin= » av-medium-margin= » av-small-margin= » av-mini-margin= » mobile_breaking= » mobile_column_order= » border= » border_style=’solid’ border_color= » radius= » min_col_height= » padding= » av-desktop-padding= » av-medium-padding= » av-small-padding= » av-mini-padding= » svg_div_top= » svg_div_top_color=’#333333′ svg_div_top_width=’100′ svg_div_top_height=’50’ svg_div_top_max_height=’none’ svg_div_top_flip= » svg_div_top_invert= » svg_div_top_front= » svg_div_top_opacity= » svg_div_top_preview= » svg_div_bottom= » svg_div_bottom_color=’#333333′ svg_div_bottom_width=’100′ svg_div_bottom_height=’50’ svg_div_bottom_max_height=’none’ svg_div_bottom_flip= » svg_div_bottom_invert= » svg_div_bottom_front= » svg_div_bottom_opacity= » svg_div_bottom_preview= » fold_type= » fold_height= » fold_more=’Read more’ fold_less=’Read less’ fold_text_style= » fold_btn_align= » column_boxshadow= » column_boxshadow_width=’10’ column_boxshadow_color= » background=’bg_color’ background_color= » background_gradient_direction=’vertical’ background_gradient_color1=’#000000′ background_gradient_color2=’#ffffff’ background_gradient_color3= » src= » src_dynamic= » background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight= » highlight_size= » fold_overlay_color= » fold_text_color= » fold_btn_color=’theme-color’ fold_btn_bg_color= » fold_btn_font_color= » size-btn-text= » av-desktop-font-size-btn-text= » av-medium-font-size-btn-text= » av-small-font-size-btn-text= » av-mini-font-size-btn-text= » animation= » animation_duration= » animation_custom_bg_color= » animation_z_index_curtain=’100′ parallax_parallax= » parallax_parallax_speed= » av-desktop-parallax_parallax= » av-desktop-parallax_parallax_speed= » av-medium-parallax_parallax= » av-medium-parallax_parallax_speed= » av-small-parallax_parallax= » av-small-parallax_parallax_speed= » av-mini-parallax_parallax= » av-mini-parallax_parallax_speed= » fold_timer= » z_index_fold= » css_position= » css_position_location= » css_position_z_index= » av-desktop-css_position= » av-desktop-css_position_location= » av-desktop-css_position_z_index= » av-medium-css_position= » av-medium-css_position_location= » av-medium-css_position_z_index= » av-small-css_position= » av-small-css_position_location= » av-small-css_position_z_index= » av-mini-css_position= » av-mini-css_position_location= » av-mini-css_position_z_index= » link= » link_dynamic= » linktarget= » link_hover= » title_attr= » alt_attr= » mobile_display= » mobile_col_pos=’0′ id= » custom_class= » template_class= » aria_label= » element_template= » one_element_template= » show_locked_options_fakearg= » av_uid=’av-29ba1y’ sc_version=’1.0′]
[av_textblock fold_type= » fold_height= » fold_more=’Read more’ fold_less=’Read less’ fold_text_style= » fold_btn_align= » textblock_styling_align=’justify’ textblock_styling= » textblock_styling_gap= » textblock_styling_mobile= » size= » av-desktop-font-size= » av-medium-font-size= » av-small-font-size= » av-mini-font-size= » font_color= » color= » fold_overlay_color= » fold_text_color= » fold_btn_color=’theme-color’ fold_btn_bg_color= » fold_btn_font_color= » size-btn-text= » av-desktop-font-size-btn-text= » av-medium-font-size-btn-text= » av-small-font-size-btn-text= » av-mini-font-size-btn-text= » fold_timer= » z_index_fold= » id= » custom_class= » template_class= » element_template= » one_element_template= » av_uid=’av-m1kuictn’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg= »]
Entre les fameuses épreuves externes, type CEB, CE1D et CESS, les sessions d’examens dans le secondaire (en juin et parfois en décembre), ainsi que les contrôles tout au long de l’année, les élèves francophones sont confrontés à une multitude d’évaluations durant leur parcours. La déclaration de politique communautaire, feuille de route du nouveau gouvernement MR-Engagés, prévoit même d’intensifier le recours aux évaluations externes communes à tous les élèves. Avec l’introduction d’une nouvelle épreuve en 3e primaire portant sur la maîtrise des compétences de base et le maintien du caractère certificatif du CEB en 6e primaire, pourtant censé devenir une épreuve indicative avec l’avancée du tronc commun.
« Beaucoup de personnes, surtout à gauche de l’échiquier politique, étaient favorables à la disparition du CEB », avance Etienne Michel, directeur général du Segec (le Secrétariat général de l’enseignement catholique). « Ils ont du mal à comprendre qu’il s’agit parfois du seul diplôme pour une certaine catégorie de la population. Maintenir le CEB répond aussi à une logique sociale. » Il est également prévu de porter le seuil de réussite de toutes ces épreuves à 60 %. « Ça fait 20 ans que je suis au Segec et j’ai constaté qu’il existait des variations dans le niveau des épreuves du CEB. Le message politique est certainement de vouloir en faire une évaluation discriminante. » Le CE1D en 2e secondaire sera remplacé par le certificat du tronc commun en fin de 3e secondaire. Mais pourquoi accorder autant de place à l’évaluation dans notre système éducatif ?
Culture méritocratique
A l’instar du système éducatif français, mais dans une moindre mesure, l’enseignement belge se caractérise par une culture méritocratique et sélective, avec un taux de redoublement très important. « On est dans un système qui classe et qui trie les élèves relativement tôt dans leur parcours scolaire par rapport à d’autres systèmes plus intégrateurs comme les pays nordiques », analyse Hugues Draelants, sociologue de l’éducation (UCLouvain). « Depuis quelques années, avec la mise en œuvre du Pacte d’excellence, on tend à vouloir lutter contre l’échec scolaire, bien que ça ne se traduise pas toujours dans les faits. »
L’évaluation ferait donc partie de notre culture scolaire. « Lorsqu’on interroge les parents, ou le grand public, sur les devoirs et les évaluations, on entend tout et son contraire. Certains vous diront que l’on en fait beaucoup trop, ce qui empêche les jeunes d’avoir des activités extrascolaires, d’autres diront que l’on n’en fait pas assez », nuance Julien Nicaise, administrateur délégué de Wallonie-Bruxelles Enseignement, le réseau officiel de la Communauté française.
Pour Natacha Duroisin qui dirige le service d’éducation et des sciences de l’apprentissage à l’Université de Mons, l’évaluation ne doit pas avoir mauvaise presse, au contraire. « Elle remplit de nombreux objectifs dans le processus d’apprentissage : identifier les domaines où les élèves sont en difficulté, adapter les apprentissages aux besoins des apprenants, réactiver les connaissances, consolider les apprentissages en mémoire, donner des informations aux parents et aussi servir de levier pour motiver les élèves. »
Il y a évaluation… et évaluation
L’experte en psychologie des apprentissages distingue plusieurs types d’évaluations, selon les objectifs poursuivis. « Les évaluations sommatives, qui génèrent des points, entendent mesurer les progrès de l’élève par rapport à des objectifs fixés. Elles se placent à la fin d’une séquence d’apprentissage. L’idéal est de donner un feedback pour que l’élève puisse réajuster le tir. » A côté, il existe les évaluations formatives en cours d’apprentissage pour veiller à la compréhension de l’apprenant.
La proportion entre ces types d’évaluations serait différente selon les systèmes éducatifs. « Il y a beaucoup de systèmes scolaires, notamment dans les pays scandinaves, où l’on mobilise bien moins d’évaluations sommatives », soutient Ariane Baye, professeure en sciences de l’éducation à l’ULiège. « Ils proposent des évaluations formatives qui ne servent pas à établir des bilans chiffrés. La Belgique francophone est dans un système similaire à celui de son voisin français avec des évaluations auxquelles sont attribués des points, sans forcément un suivi par la suite. La plus-value d’un point de vue pédagogique est moins démontrée, car on perd parfois du temps sur les apprentissages. »
Principe de liberté pédagogique
Suivant le principe de liberté pédagogique, cher à la Belgique, l’organisation des évaluations est exempte de règles strictes. De nombreuses écoles ont entamé une réflexion concernant l’évaluation ; la diminution du nombre de jours blancs, dédiés aux examens et aux délibérations, rend plus difficile le maintien de deux sessions d’examens en décembre et en juin. Sous la précédente législature, avec le changement des rythmes scolaires, le parlement avait voté en faveur de la suppression des évaluations la semaine suivant les congés scolaires, afin d’en faire de véritables périodes de repos. Le nouveau gouvernement entend évaluer la pertinence de cette interdiction pour laisser davantage d’autonomie aux enseignants et directions. « L’absence d’évaluations la semaine qui suit les vacances est une bonne chose, mais dans le secondaire, on constate énormément d’évaluations la deuxième semaine, avec parfois quatre interrogations le même jour », pointe Julien Nicaise qui plaide pour un calendrier partagé entre les enseignants.
Si les évaluations internes dépendent largement de l’établissement scolaire, reste les évaluations externes identiques pour tous les élèves francophones, qui se sont largement développées ces vingt dernières années. « Pendant longtemps, les enseignants ont été juge et partie », constate le professeur Draelants. « En dispensant les apprentissages aux élèves et en les évaluant par la suite, des biais peuvent être introduits. Les évaluations externes amènent davantage d’équité entre les élèves. Elles apportent aussi des informations précieuses pour le pilotage du système éducatif, elles permettent aux écoles de voir où leurs élèves se situent par rapport à la moyenne et d’ajuster leur action pédagogique en conséquence. Le revers de la médaille est qu’elles donnent lieu à beaucoup d’inquiétudes dans les familles. Le CEB a une très forte visibilité sociale, ça donne lieu chaque année à des articles dans les médias. »
De leur côté, les associations de parents estiment que l’école consacre beaucoup de temps aux évaluations, « ce qui s’accompagne pour un certain nombre d’élèves, parfois très tôt dans leur parcours, de stress et de désillusions », soutient l’Ufapec, l’Union des parents de l’enseignement catholique. Sans compter les tensions au sein des familles que peuvent générer les évaluations. « Aujourd’hui, ne pas obtenir ces certificats scolaires est bien plus handicapant que par le passé », poursuit Hugues Draelants. « Se définir comme élève, c’est d’abord se définir dans le miroir que l’institution nous tend, et donc par le verdict posé par l’institution via l’évaluation. » Le cauchemar de l’évaluation, éternelle reviviscence des années d’études.
@Le soir Par Charlotte Hutin ,journaliste au pôle Société
[/av_textblock]
[/av_one_full]